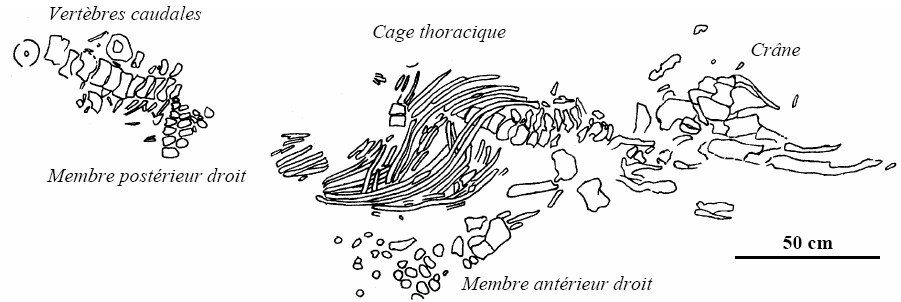Nous sommes à nouveau dans les Alpes-de-Haute-Provence où aucun arrêté d’interdiction de circuler dans les massifs n’a été pris pour l’été, contrairement aux Bouches-du-Rhône. Les premières randonnées nous ont convaincus de continuer nos découvertes. Départ juste après le tunnel de Pérouré, peu avant 18h : c’est la présence des boites aux lettres de la chapelle, en bordure de la D900, qui nous confirment le départ du sentier. Le Bès tourmenté circule entre les nombreuses couches rocheuses inclinées. L’indication d’un sanctuaire attise notre curiosité.
herman de vries a accepté avec enthousiasme d’implanter Le Sanctuaire de la nature en ces lieux. Situé en altitude sur le site de roche-rousse, le dispositif du sanctuaire enserre avec des piques en fer forgé dont les pointes sont dorées à l’or fin, une ancienne maison forestière en ruine, habitée par de vieux buis, des rosiers et des arbustes. Comme une guérison, dit Herman de Vries, comme en ville où la nature retrouve sa place dans la moindre parcelle de terrain vague. Que gagnons-nous à faire un sanctuaire avec une grille plaquée d’or ? On ne gagne rien, mais il n’est pas nécessaire de toujours gagner quelque chose sur la nature. Avec cette attitude, je veux réintégrer dans cette nature la notion du sacré pour un moment de réflexion.
Peu après le sanctuaire, à l’entrée d’un bois que nous n’avons pas hésité à qualifier de sacré, tout comme herman de vries, une pique sur laquelle le mot « silence » est gravé en lettres d’or. Cette inscription fait partie du projet traces (CAIRN) ; elles sont gravées dans la pierre à des endroits choisis par l’artiste dans la Réserve Géologique. Ces traces fonctionnent comme les notes de bas de page du paysage. Avec le mot silence commence la méditation. Nous y avons vu un lien avec l’ermitage orthodoxe.
Un centre d’art, le Centre d’Art Informel et de Recherche sur la Nature (CAIRN), regroupant le musée et la réserve a été créé pour développer une programmation tournée vers l’art contemporain : Andy Goldsworthy par exemple a réalisé une œuvre dans le refuge d’art du vieil Esclangon (voir Et si le vélodrome n’était pas à Marseille ?).
Cet « ambulo ergo sum » peint sur un rocher, nous a bien surpris également : sans mouvement nous n’existons plus (formule empruntée à Gassendi, philosophe et mathématicien, né près de Digne en 1592). herman de vries veut nous donner la possibilité de réfléchir sur notre propre démarche dans l’instant…
Après quelques avertissements incitant au silence, nous parvenons à la chapelle orthodoxe St-Jean bien cachée en haut de la montagne, dans la verdure. Coquette avec sa coupole à bulbe rouge, elle nous incite à pénétrer par la porte entrouverte. Une coupole sur le nef de l’église symbolise le ciel au-dessus de la terre (voir lexique orthodoxe). Les clochers à bulbe sont caractéristiques de l’architecture religieuse russe. Au sommet, la croix orthodoxe à huit branches : la transversale supérieure, c’est l’écriteau qui portait l’inscription « Jésus de Nazareth Roi des Juifs ». La transversale médiane, c’est la pièce de bois où furent cloués les mains du Christ. Quant à la transversale inférieure qui correspond à la pièce de bois où furent fixés les pieds, elle est disposée en biais car elle évoque les deux larrons crucifiés avec le Christ : le mauvais larron la tire vers le bas (L’Enfer) tandis que le bon larron la tire vers le haut (le Ciel).
Principales caractéristiques d’une église orthodoxe :
– l’absence de statues et de sculptures et l’importance des icônes,
– l’iconostase : c’est une haute cloison qui sépare le sanctuaire où se trouve l’autel de la nef où se trouvent les fidèles,
– l’absence d’orgues.
Extrait du site Russie sur Seine
Derrière le drapé blanc placé devant la porte, vit un ermite orthodoxe que nous ne voulons pas déranger. De quoi vit-il ? pas de trace de culture ni d’élevage, 1h30 pour rejoindre la départementale, peu d’habitations et aucun commerce dans les environs…
Le balisage jaune continue : nous décidons de le suivre bien que ne sachant pas trop où il nous conduira. Un sentier balisé a quelque chose de rassurant : il mène toujours à bon port. Il est à peine visible dans les bois, il circule parfois sur des dalles rocheuses, parfois en sous-bois, toujours en zig-zag s’éloignant de notre point de départ, et descendant rapidement dans le vallon. Où sommes-nous ? Quand au loin je reconnais la lame de Facibelle, après en avoir douté au moins une dizaine de fois, je comprends que je suis au cœur du vélodrome, cette fameuse curiosité géologique que nous avions en vision panoramique deux semaines auparavant (voir Et si le vélodrome n’était pas à Marseille ?). Je ne le reconnais pas et j’en suis décontenancée. De loin, la lame semblait fine, frêle et gonflée comme une voile au vent. De près, c’est un amas de gros rochers grossièrement posés les uns sur les autres et qui tiennent on ne sait trop comment, miracle d’équilibre mis en relief par l’érosion. Peu après, c’est un passage à gué avec une superbe marmite sur le cours de l’Adret.
Retour en suivant la direction de la passerelle sur le Bès. Nous descendons encore et encore jusque dans un sous-bois si sombre qu’on croirait la nuit tombée. La passerelle est en vérité un pont suspendu tenu par des câbles métalliques. Pour traverser le torrent, il faut jouer à Indiana Jones. Pas d’autre solution. Et croyez moi, plus on avance plus elle bouge !
Le retour vers le parking se fait sur la route départementale à bonne allure. Quand nous parvenons au tunnel de Pérouré, nos regards se fixent sur un objet insolite : une sorte de grande nasse suspendue au-dessus du torrent. Toutes nos hypothèses progressivement s’écroulent. Il n’en reste qu’une : que ce soit une œuvre d’art contemporain comme il en existe tant dans le territoire de la réserve. Je pensais à une œuvre de Hubert Duprat qui avait prévu de laisser une trace lui aussi mais il s’agit d’une chrysalide ou nasse de pêcheur, œuvre d’un workshop. L’objectif de cet atelier est la production et l’installation, par les étudiants de l’école, d’une œuvre d’art qui restera en place sur la VIAPAC [via per l’arte contenporanéo = voie pour l’art contemporain] pendant deux années. Pour suivre au jour le jour le workshop de Digne, par le texte et la photo, voyez le blog des étudiants. » Extrait du site de l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Nantes.
Une balade pleine de surprises avec parfois l’impression d’un parcours aventureux. Boucle sanctuaire de la nature – St-Jean – voile de Facibelle – passerelle de 7.100km, dénivelée 457m, 3h