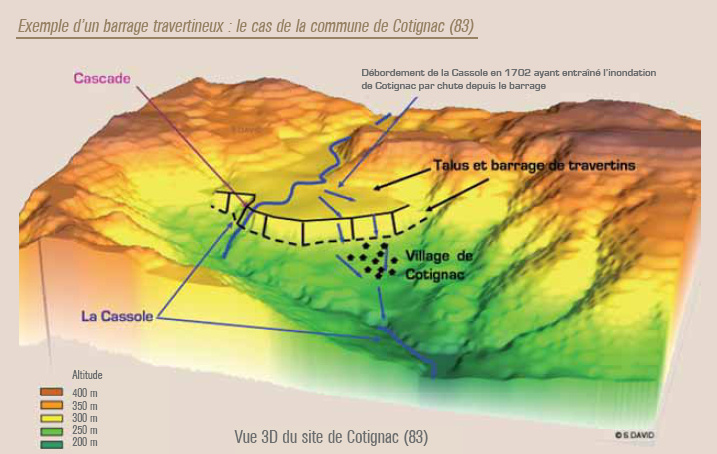Balade sans prétention mais fort agréable au sommet de cette petite colline dominant la Napoule dans le parc départemental du San Peyre de 18 ha. « Dans ce parc situé dans une zone urbaine, au milieu des pins, des chênes-lièges et des mimosas, vous apprécierez les couleurs et senteurs des espèces du maquis (bruyère, arbousiers, cistes) ainsi que les formes particulières des cactées ».
Parc départemental du San Peyre
La météo à cet endroit, aujourd’hui et à 3 jours
avec le vent

Nous faisons rapidement le tour de la colline sur un chemin enneigé, puis nous montons par une allée tout en dalles rosées et larges zigzags. Un chat que l’on dirait presque sauvage, tant il est gros et d’une immobilité presque menaçante, nous observe 2m plus haut. La montée continue et régulière en fait une balade familiale facile quelles que soient les conditions météorologiques. Au sommet, se devinent l’ancienne chapelle – et un donjon – celui du château d’Avignonet. [Mémoires de la Société des sciences naturelles, des lettres et des beaux-arts de Cannes et de l’arrondissement de Grasse], Cannes, 1876
Guy de Maupassant, au cours de ses promenades, rencontra un ermite qui vivait retiré dans la chapelle au sommet du mont. Cela lui inspira une nouvelle (l’ermite) parue dans Gil Blas en 1886. Des années plus tard, le mont San Peyre était rebaptisée grâce à lui « la montagne sacrée ».
Oscar Wilde y est venu se reposer aux frais d’un ami. Il est conquis par cette symphonie de parfums et de couleurs : « bleu saphir de la mer, rouge chaud des porphyres, luminosité du ciel et profusion des fleurs ».
 En 1242, le castrum de Mandelieu et le castrum d’Avignonet sont englobés dans les biens de l’Église d’Antibes où est situé alors l’évêché. L’évêque de Fréjus donne l’église et le château à Lérins. Raymond d’Avignonet s’en empare par la force puis les restitue dès qu’il est condamné en 1272. Les moines de Lérins, ravis de son attitude empressée, les lui cèdent alors et ne gardent qu’un droit de suzeraineté. En 1390, le château d’Avignonet est détruit par les troupes du vicomte de Turenne.
En 1242, le castrum de Mandelieu et le castrum d’Avignonet sont englobés dans les biens de l’Église d’Antibes où est situé alors l’évêché. L’évêque de Fréjus donne l’église et le château à Lérins. Raymond d’Avignonet s’en empare par la force puis les restitue dès qu’il est condamné en 1272. Les moines de Lérins, ravis de son attitude empressée, les lui cèdent alors et ne gardent qu’un droit de suzeraineté. En 1390, le château d’Avignonet est détruit par les troupes du vicomte de Turenne.

La chapelle chapelle Saint-Pierre (San Peyre) a donné son nom au site ; de beaux parements de porphyre vert jouent avec ceux de prophyres rouges typiques de l’Esterel. Bien qu’elle n’ait plus que les murs, on peut deviner sa forme et sa taille avec ce qu’il en reste.

 Là haut, une seule table de pique-nique près du poste d’observation, et une table d’orientation face au Mercantour et à la côte exceptionnellement enneigée : d’ailleurs, l’alerte orange déclenchée depuis la veille nous a contraints à trouver refuge à Cannes.
Là haut, une seule table de pique-nique près du poste d’observation, et une table d’orientation face au Mercantour et à la côte exceptionnellement enneigée : d’ailleurs, l’alerte orange déclenchée depuis la veille nous a contraints à trouver refuge à Cannes.
 Ce parc est situé sur une des coulées de rhyolite1 (coulée principale à l’ouest, coulée du Vinaigre, coulée de Théoule, coulée San Peyre) , roche volcanique effusive, venant du volcan de Maure-Vieille lors de ses périodes d’activité. Aussi quand vous chercherez la cache du volcan de la Napoule GC1GRE8, de TacTac, ne cherchez pas le volcan lui-même : il se situe quelques kilomètres à l’ouest. Actif pendant 50 millions d’années, il a projeté des émissions de lave à grande distance comme dans les gorges de Pennafort. De ce volcan, il reste la caldeira2de Maure-Vieille, « large dépression générée par l’effondrement d’un édifice volcanique suite à une éruption explosive majeure qui aurait partiellement ou complètement vidée la chambre magmatique ». Merci à Papyfred et richardmin du forum de géologie, pour leur aide.
Ce parc est situé sur une des coulées de rhyolite1 (coulée principale à l’ouest, coulée du Vinaigre, coulée de Théoule, coulée San Peyre) , roche volcanique effusive, venant du volcan de Maure-Vieille lors de ses périodes d’activité. Aussi quand vous chercherez la cache du volcan de la Napoule GC1GRE8, de TacTac, ne cherchez pas le volcan lui-même : il se situe quelques kilomètres à l’ouest. Actif pendant 50 millions d’années, il a projeté des émissions de lave à grande distance comme dans les gorges de Pennafort. De ce volcan, il reste la caldeira2de Maure-Vieille, « large dépression générée par l’effondrement d’un édifice volcanique suite à une éruption explosive majeure qui aurait partiellement ou complètement vidée la chambre magmatique ». Merci à Papyfred et richardmin du forum de géologie, pour leur aide.
Géologie découverte de Maure-Vieille, document pdf par Maurice Moine. Schémas, photos, explications des 3 phases, lecture du paysage
Afficher sur carte satellite le Parcours de découverte géologique de la caldeira de MaureVieille établi d’après le document de Maurice Moine ci-dessus. Sur la droite, la colline du San Peyre.
Image de l’itinéraire du San Peyre, 1km850, 35mn dépl. (1 petite heure au total), 81m dénivelée
![]()
1caldeira (ou caldera) : du portugais caldeira qui signifie chaudron
2rhyolite : le magma acide (à teneur élevée en silice) a donné des laves riches en gaz et très fluides appelées rhyolites ou prophyres rouges